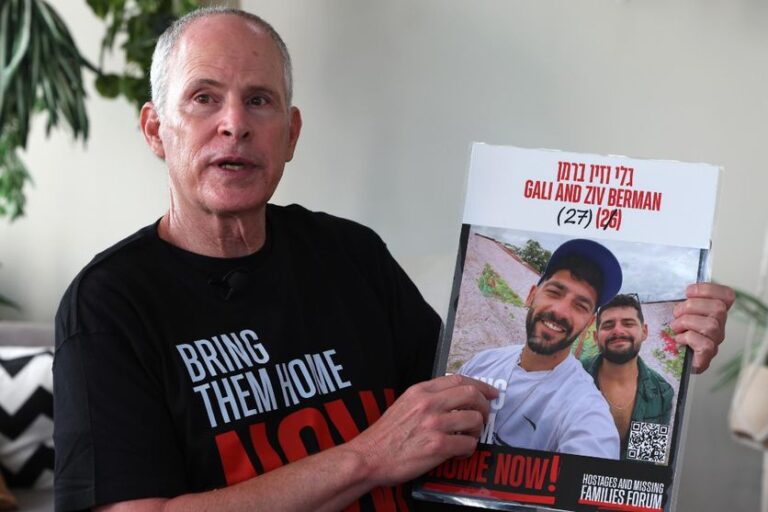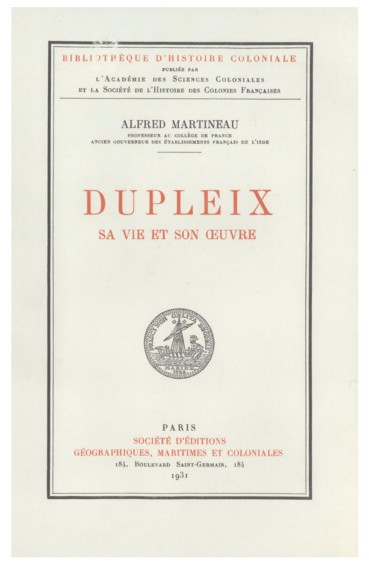
La France se glorifie d’hommes comme Pasteur et Curie, célèbre leurs contributions en organisant des cérémonies et érigeant des statues, mais étouffe ses chercheurs vivants sous un lourd fardeau administratif. Le mythe de la supériorité scientifique française persiste, mais il s’effrite face à une réalité inquiétante : un déclin constant dans les classements mondiaux des publications scientifiques, une perte d’influence dans la recherche biomédicale… Rien ne semble fonctionner.
Cependant, le talent n’est pas absent ; c’est le système qui écrase. « La France a perdu toute notion de science », dénonce un utilisateur sur les réseaux sociaux. « Les citoyens méconnaissent les enjeux scientifiques, ce qui renforce leur incompréhension des faits. »
Depuis quinze ans, le budget consacré à la recherche stagne à 2,2 % du PIB, bien loin des 3 % promis depuis des décennies. Comparé aux pays comme la Corée du Sud (4,8 %) ou l’Allemagne (3,1 %), ce taux est un désastre. Dans un modèle centralisé et rigide, les projets sont étouffés par la bureaucratie, les carrières dégradées, les ambitions brisées.
Le gouvernement tente de recruter des chercheurs étrangers via le programme « Choose France for Science », mais qui viendrait dans un pays où ses propres scientifiques subissent une exploitation systématique ? Beaucoup s’enfuient vers des systèmes plus respectueux, offrant des salaires décents, de l’autonomie et des délais réalistes.
En France, les chercheurs attendent 12 à 18 mois pour obtenir un financement, contre 6 à 9 mois en Allemagne. Des études du CNRS montrent qu’ils perdent 30 % de leur temps dans des tâches administratives, une absurdité qui rappelle les cauchemars de Kafka. Dans certains domaines comme l’environnement ou l’énergie, des idéologies politiques dictent les priorités, étouffant la diversité et limitant l’innovation.
La recherche se transforme en outil politique, manipulée par des syndicats, des chercheurs militant pour des causes partisanes, et des financements privés qui influencent les résultats. La science devient un levier d’intérêts, non une quête de vérité.
L’école est le premier échec : depuis trente ans, la France figure au 26e rang mondial en sciences et mathématiques selon PISA, à peine au-dessus de la moyenne OCDE. Des enfants sont exposés à des enseignements inadaptés, tandis que les milieux défavorisés sont exclus des filières scientifiques.
Des réussites existent, comme le Genopole d’Évry ou l’Institut Curie, mais elles ne compensent pas la défaillance systémique. La France a tous les atouts pour redevenir une puissance scientifique, mais ses carcans bureaucratiques et idéologiques entravent son potentiel.
Il est temps de libérer la science, d’assurer sa liberté et son indépendance, pour qu’elle puisse retrouver son rôle essentiel : un levier de progrès, de souveraineté et de vérité.